Le retour

Il était parti depuis si longtemps. Et pourtant il se souvenait, comme si c’était hier, de l’odeur des feux de charbon, du grondement de la mer à marée montante, du goût des mangues encore vertes qui irritaient la bouche autant qu’elles rafraîchissaient, du froissement des feuilles de palmes dans le vent. Il se rappelait ses jeux avec les enfants du village, jusqu’à l’épuisement où, la peau durcie de sel, les genoux irrités de sable, il fallait regagner la maison.
La mémoire, certes, est trompeuse. Quarante années avaient passé, quarante années où il n’avait pas osé revenir. Pas osé confronter l’éclat de ces jours d’enfance avec une réalité qu’il lui fallait aborder en adulte. C’était son secret, son Madagascar qu’il ne tenait pas à partager. Simplement le coeur qui bat plus vite quand à côté de lui, au restaurant, dans un bus, le nom jaillissait d’une conversation. Une grande bouffée d’odeur de
sable, la moiteur de ces enclaves de forêts qui enchevêtraient leurs lianes au milieu de terres toujours menacées par l’avancée des cultures, des villages qui multipliaient leurs cases. Il ne trouvait rien à dire quand des touristes, le prenant pour un ignorant, lui assénaient leurs connaissances toutes neuves d’un pays qu’il avait la sensation d’avoir perçu dans son intimité de paradis. Avec des Malgaches, peut-être, il aurait pu parler. Mais il n’y en avait guère dans son coin de région parisienne et ceux qu’il croisait parfois étaient pour la plupart originaires des Hautes Terres.
Fort Dauphin, c’était une île dans une île. Et dans cette île encore, il y avait son île à lui, celle d’une enfance coupée nette, comme tranchée à la machette. Des mots demeuraient, français, malgaches, des mots de tous les jours, canne à sucre, tamarin, sambo, rakety qui prenaient écho en lui quand il les évoquait à voix basse, jusqu’à l’étourdissement.
Pourtant, il le savait, il l’avait appris plus tard de sa mère, de son père, la vie de ces temps-là n’avait pas été facile. Les petits planteurs, surtout fantasques comme l’était son père, étaient aussi fragiles qu’une jeune pousse de filao. Trop de vent, trop de soleil, trop peu de pluie, une invasion de criquets… On avait essayé les arachides, la canne à sucre, le sisal, les plantes maraîchères… À bien des repas, les gros haricots blancs, les kabaro, étaient leur seul loaka pour accompagner le riz. Pour économiser ses chaussures, il marchait souvent pieds nus. Il en était heureux à vrai dire, il se sentait devenir malgache. Il oubliait que dans la bande d’enfants dépenaillés il était le seul Blanc. Et peut-être que les autres, dans la fureur du jeu, l’oubliaient aussi.
Quarante ans après, l’arrivée à Tananarive lui avait fait l’effet d’une gifle. C’était pour lui, il est vrai, la ville du départ. Il avait alors douze ans, douze ans de plus que l’Indépendance. Si les images qu’il gardait de ses derniers instants malgaches demeuraient brouillées, il revivait la même sensation de froid, de débâcle. Son père, lèvres serrées, courbé sous le poids de la valise en carton bouilli. Sa mère, le visage tiré d’angoisse, avec sa voix cassante des mauvais jours. Ils fuyaient. Finalement, après avoir tenté jusqu’à l’impossible, ils abandonnaient ce pays où ils avaient cru se construire une vie et qui, selon les mots de son père, les rejetait comme on crache un pépin d’orange. Ils étaient partis, et à part son frère aîné, ils ne s’en étaient jamais remis.
De cette ville moderne, il n’avait rien aimé. Presque rien retrouvé de la magie malgache de ses souvenirs. Il s’était dit que cela irait mieux plus loin, plus au sud, quand la mer serait à portée de regard.
Il avait débuté son voyage en touriste ordinaire. Un chauffeur de taxi qui connaît quelqu’un qui connaît quelqu’un qui a une voiture, et qui pouvait l’emmener où il voulait. Très vite, cela n’avait pas été. Un pneu crevé, puis un autre, puis le moteur qui chauffe. Et puis surtout, le chauffeur guide qui ne cessait de lui parler comme s’il était venu pour visiter les parcs, voir les lémuriens, trouver de jolies filles. Il en allait de sa faute aussi : il n’avait rien dit, pas raconté, pas essayé de retrouver les quelques mots de malgache qui remontaient de sa mémoire dans l’ambiance des marchés, des gargotes où il buvait du rhum dans des petits verres sales. Que pouvait-il dire d’ailleurs ? Qu’à cinquante ans passés, il espérait retrouver le petit garçon qu’il avait perdu de vue depuis tant d’années, le petit garçon qui se réjouissait de chaque jour pointant à l’aurore, sans se soucier du lendemain ? Il était devenu un adulte triste, pour qui chaque jour était une nouvelle épreuve.
À Fianarantsoa, il avait décidé de poursuivre en taxi-brousse. Son chauffeur guide le lui avait vivement déconseillé : la route était longue, épuisante, monotone. Des kilomètres et des kilomètres de mauvaise piste, de poussière…
Pourtant, il avait retrouvé là un frémissement. Personne, parmi les passagers, ne lui avait rien demandé. Il pouvait les écouter sans avoir l’air de les comprendre, regarder les paysages défiler, retrouver la familiarité des arbres et des plantes, sourire à la course précipitée d’un troupeau de chèvres, voir se découper sur une crête la silhouette d’un Mahafaly, campé comme un guerrier, appuyé sur sa lance. Ils s’arrêtaient pour manger des assiettées de riz arrosées de bouillon de poulet où flottaient quelques brèdes, boire des cafés sirupeux, se brûler le palais à des mofo gasy tout juste sortis de leur moule.
Enfin, après bien des heures, ils avaient atteint Fort Dauphin. Il était tard et pour la première nuit, il avait choisi un hôtel de moyenne gamme où il avait pu prendre une douche, se rassasier d’un poisson grillé, avec un rougail de tomates pour amadouer le riz. Au matin, après une bonne nuit de sommeil, il avait commencé à sentir en lui comme une petite joie, d’être vivant, d’être là.
Tout de suite, il était parti en quête de leur ancienne maison. Un taxi bringuebalant l’avait emmené par une route de creux et de bosses jusqu’au village dont il se rappelait encore le nom. Cette fois-ci, il avait parlé, en mentant un peu, racontant que ses parents avaient habité là autrefois, alors qu’il n’était pas encore né.
Le village existait toujours. Bien différent de ce qu’il avait connu, certes, mais avec les mêmes constructions de cases, et l’école en dur où il avait fait ses premières classes. Leur maison était encore à trois kilomètres, mais soudain, il ne savait plus. Peut-être avait-elle disparu, ou n’était plus qu’une ruine qui servait de latrines.
Il était là, indécis, fumant une cigarette dans l’ombre du grand kily, quand quelqu’un s’était approché.
– Tu es Marcel Debouraux ?
C’était un tout jeune homme, qu’il ne pouvait pas avoir connu. Mais les nouvelles vont vite dans les petits villages.
Eka ! avait-il répondu.
– Alors, suis-moi.
Il avait suivi l’homme qui l’avait mené à l’autre bout du village, en passant par des ruelles de sable où les gens l’interpellaient d’un « Salut vazaha » auquel il ne savait que répondre. Ils étaient arrivés devant une petite maison en planches, au toit de tôle, et l’homme lui avait montré la porte.
– Entre. Elle t’attend.
Franchissant le seuil, il avait été saisi par l’odeur douceâtre de chauve-souris qui, loin de le rebuter, le ramenait loin en arrière. Ses yeux s’étant acclimatés à l’obscurité après la grande luminosité du dehors, il avait aperçu une femme, une vieille femme, allongée sur un lit. Il s’était avancé.
– Marcel ? avait dit la vieille.
Elle levait dans sa direction des yeux tout blanchis de cataracte. Mais à l’instant même où il avait entendu sa voix, il l’avait reconnue.
– Joséphine ?
Elle souriait.
– Approche-toi.
Elle tendait vers lui ses mains qui tremblaient un peu, et montait vers lui son parfum, fumée de charbon, sel et sueur, léger comme un souffle.
Il s’assit sur le lit, et avec une douceur qu’il avait oubliée et qui lui fit venir les larmes aux yeux, elle posa ses mains sur son visage, ses mains si caressantes, malgré la peau rêche de travail, ses mains aux si longs doigts qui l’avaient baigné, langé, ses mains qui l’avaient apaisé quand il s’était fait mal, quand il avait peur, les mains de sa nourrice.
Alors, à cet instant-là, dans un éblouissement de joie, il sut qu’il était revenu chez lui.
Par #LaurenceInk





















































































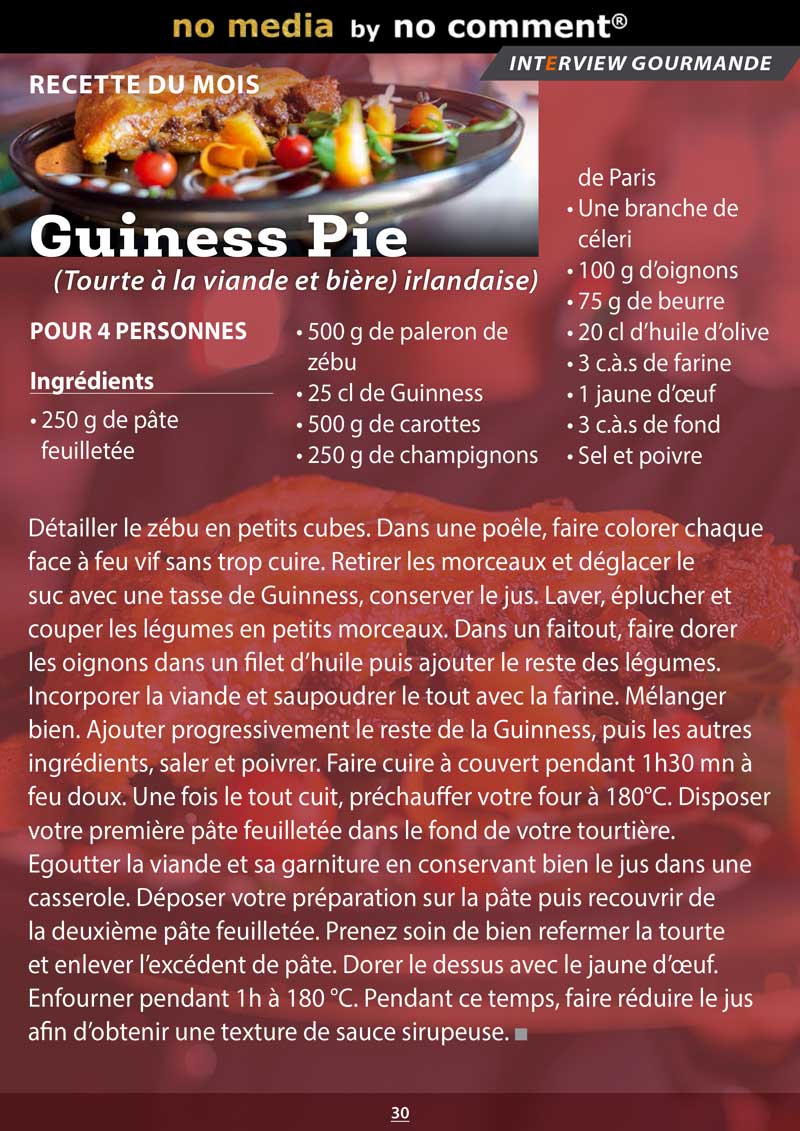

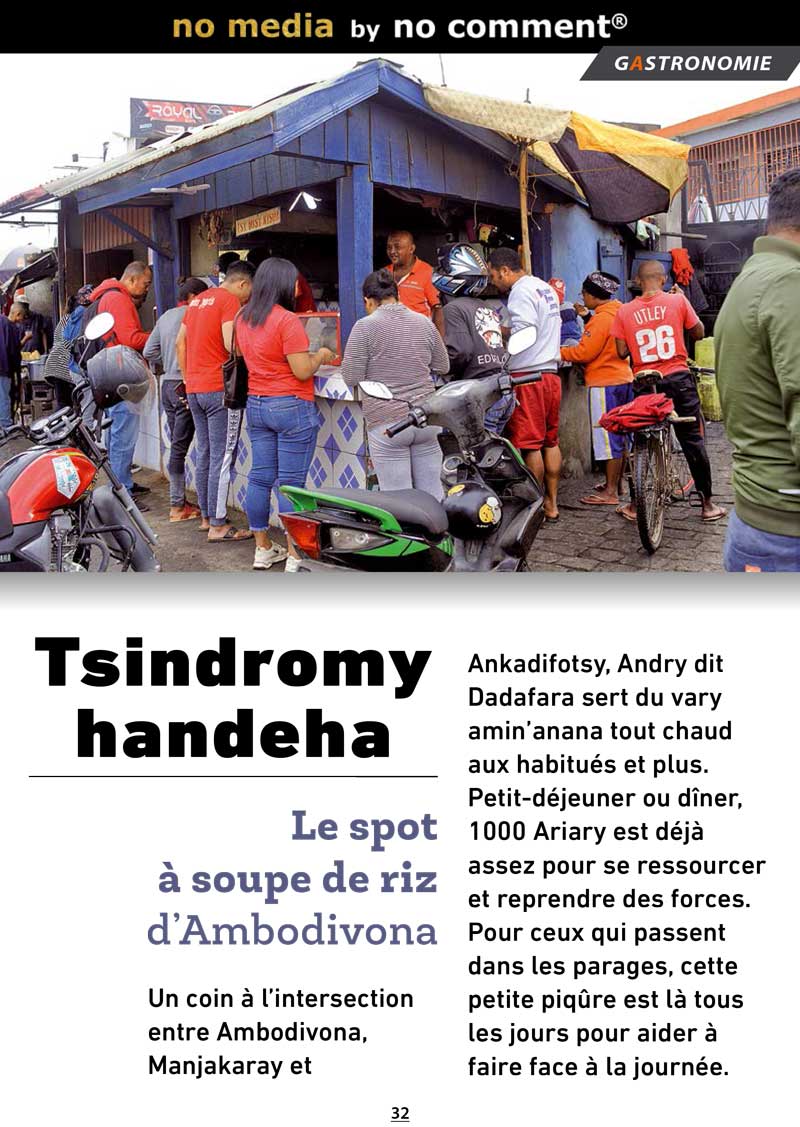






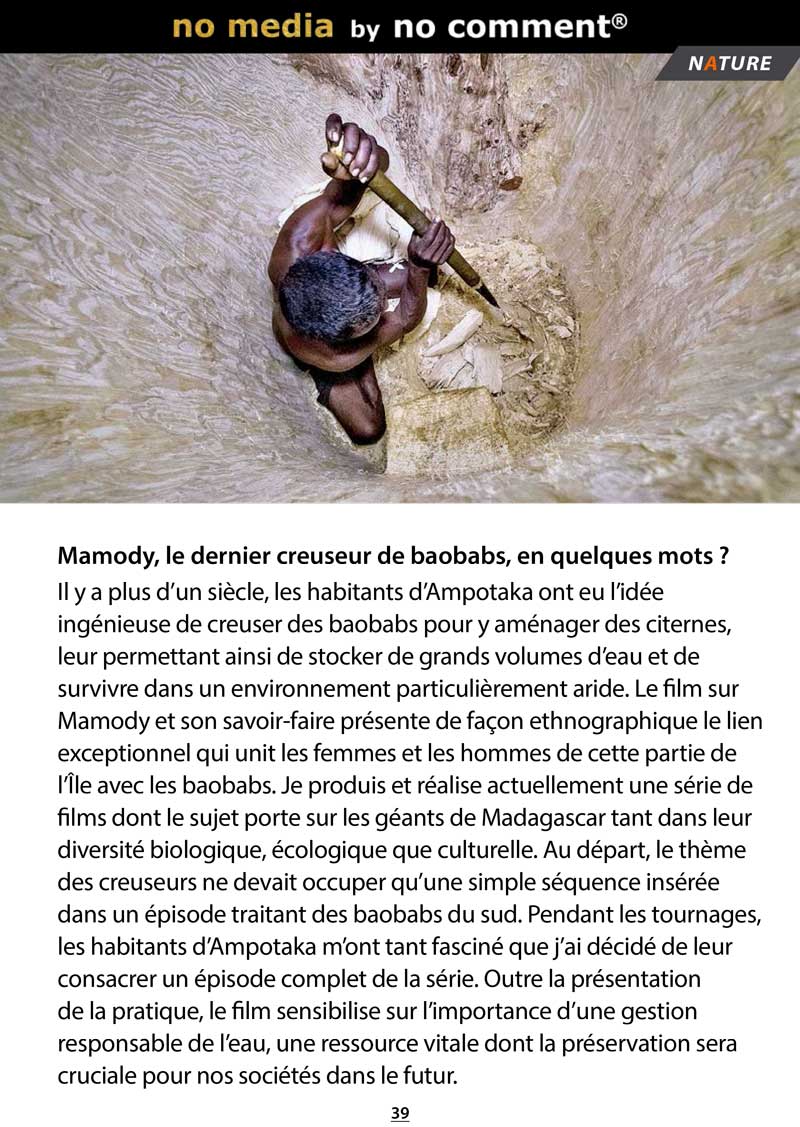




















COMMENTAIRES