Dernière lettre
Ils l’avaient annoncé pour quatre heures du matin. Ce n’était ni le premier, ni certainement le dernier. Mais malgré tout, elle ne s’y habituait pas. Le ciel s’était couvert dès l’après-midi de noirs nuages, avec quelques éclaircies au milieu, comme des trous dans une vieille couverture militaire. Le vent avait commencé dans la nuit, ce grondement pareil à la mer, par vagues, qui tapait contre les murs, violemment, comme des coups de boutoirs, et faisait trembler les tôles du toit. Incapable de dormir, elle était demeurée les yeux ouverts dans le noir, écoutant la respiration de la dernière de ses filles qui partageait toujours son lit. Attendre. Il n’y avait rien d’autre à faire, espérer que, cette fois-ci encore, cela passerait à côté.
Elle n’avait jamais aimé le vent. Peut-être Mixon avait-il raison : elle n’était pas une vraie femme de marin. Lui vivait du vent. Le vent matinal de terre l’emmenait loin en mer pour poser ses filets, là où il n’apercevait même plus la côte, là où, avec Jilo, il attendait que le vent vire de bord, avec ses trois noix de coco fraîches pour la soif et un morceau de manioc sec pour la faim. Il s’allongeait dans le fond de la pirogue, sous la voile inutile, et dormait, Jilo en figure de proue, le regard fixé sur la mer. Et puis une brise, plus légère qu’une caresse de plume, venait le chercher dans des rêves qu’il n’avait jamais racontés à personne. Il se redressait, jetait un regard à Jilo qui déjà préparait la voile et, ayant contrôlé une dernière fois leurs filets, ils repartaient vers le village. Ils étaient presque toujours les derniers rentrés, même lorsque la mer était méchante, grise et écumeuse. Les autres pêcheurs hochaient la tête, moitié admiration moitié reproche : Mixon, disaient-ils, il n’aura pas de tombeau.
Mixon et Jilo. Au village, les gens les disaient mari et femme. Pour se moquer. Mais c’était pure méchanceté. Elle se rappelait très bien quand Mixon avait recueilli Jilo, alors qu’il n’était qu’un tout jeune garçon. Six ou sept ans peut-être. Il était arrivé à Mahabo un jour de marché, avec sa mère, une femme de loin que personne ne connaissait vraiment. Le lendemain, elle avait disparu, laissant son fils assis là où les pêcheurs tirent leur pirogue au sec. Il ne savait rien dire, que des paroles inarticulées où revenaient les sons qui étaient devenus son nom : Dzi-lou… Elle avait toujours pensé que Mixon l’avait pris avec lui pour la punir, elle qui ne lui avait jamais donné de fils. À l’époque, ils venaient tout juste de se séparer.
Pourquoi repenser à tout cela aujourd’hui, alors que le sable soulevé par le vent cinglait les murs de planches et que le jour peinait à se lever dans cet enroulement de tempête ?
Un touriste avait expliqué un jour que des oiseaux marins, comme des sternes, pouvaient demeurer prisonniers d’un cyclone, enfermés au centre, dans le calme de l’oeil, et se trouver ainsi emportés très loin, jusque-là où le vent, maître indomptable, choisissait de mourir. Mixon avait adoré cela, rêvant, lui aussi, de se laisser porter, avec sa pirogue, par la folie du vent. Dix ans. Cela faisait dix ans que leurs routes s’étaient séparées. Lui comme elle ne s’étaient jamais remariés. Il y avait eu d’autres femmes dans sa maison, mais elles non plus n’étaient pas restées. De son côté, elle n’avait guère eu le temps de s’intéresser à d’autres hommes, trop concentrée sur son travail à l’hôtel, occupée à gagner ce qui devait permettre à ses filles d’avoir une vie plus facile que la sienne. Non que les prétendants aient manqué. Mais elle n’avait plus confiance. L’alcool, cela vous détruit le meilleur des hommes.
Et Mixon avait été celui-là. Plus beau, plus fort que les autres, avec un sens aigu de la mer qui faisait que les hôteliers vazaha de la côte se l’arrachaient comme skipper. Ils auraient dû être heureux tous les deux. Et avec leurs trois filles.
La tempête paraissait vouloir se calmer, cesser de mugir dans sa grande colère. Le toit avait tenu. Ils étaient tous là, sains et saufs, même sa fille aînée venue trouver refuge chez elle, avec son mari et leur petit garçon, abandonnant à son sort sa maison de ravinala, si vulnérable au vent.
Il lui avait laissé la maison qu’elle avait peu à peu transformée, pour retourner vivre tout près de la mer. Dans une simple case, avec un plancher de rapaka. Elle n’y était allée qu’une dizaine de fois, pour le prévenir d’un deuil, ou si depuis trop longtemps elle ne l’avait pas vu au village. Le plus souvent, il envoyait Jilo. C’était Jilo qui allait vendre leurs poissons aux hôteliers, Jilo qui achetait les cigarettes, le sucre, l’huile… Et l’alcool. Il ne parlait toujours pas, mais il n’était pas totalement idiot. Simplement, dans sa tête, il était resté à l’âge où Mixon l’avait recueilli. Les filles allaient rarement voir leur père, sauf la dernière, quelquefois, pour lui déposer un repas de viande ou un vêtement acheté au marché. Mais elle ne s’attardait pas. Mixon pouvait être terrible quand il avait bu.
Le jour était maintenant tout à fait levé. Et même la pluie paraissait s’être arrêtée. Il y avait tout à coup un grand silence.
Julia se leva brusquement et, saisissant un lamba, s’en ceignit la taille et sortit.
Pour se rendre chez Mixon, il fallait traverser un petit bois. Le sentier était jonché de branches cassées, de nids vides, de feuilles déchiquetées. Elle avançait tête baissée, avec l’eau qui dégouttait des branches et lui ruisselait le long du dos, entre les seins. Par endroits, le chemin disparaissait sous les troncs d’arbres et les arbustes que le cyclone avait couchés. Il y avait si longtemps qu’elle n’était pas venue par ici.
Elle essayait de ne pas penser. Qu’allait-elle lui dire ? Qu’elle s’était inquiétée ? Qu’elle avait eu peur pour lui ? Tout cela n’avait aucun sens. Déjà, elle appréhendait son rire. Son rire grinçant d’ivrogne, si proche des larmes et en même temps mauvais comme un fouet. Il avait tellement changé. Il n’y avait que son corps qui, à pratiquer la mer tous les jours, était demeuré fort. Plus maigre simplement. La peau, et juste en dessous, les muscles qui jouaient et roulaient encore, comme ceux d’un bel animal. Mais le visage était déjà celui d’un vieil homme. Les joues rentrées sur l’absence de dents, les yeux troubles.
Au début, elle s’était beaucoup demandé ce qui serait arrivé si elle était restée. Si elle lui avait donné un fils… Mais l’alcool est une épouse plus jalouse, plus exigeante qu’aucune femme ne pourra jamais l’être. Elle avait perdu la partie, peut-être avant même de l’engager, avant même que leurs corps ne se trouvent. Avant qu’il ne devienne cet homme sans lequel elle avait cru ne pas pouvoir vivre.
Elle entendit la mer bien avant de l’apercevoir. C’était une grande marée. Les vagues tapaient lorsqu’elles s’enroulaient et retombaient, puis grondaient, en lançant leur écume vers le haut de la butte. La maison de Mixon était sur la droite lorsqu’on débouchait du sentier. Elle précipita son pas. Il était impossible qu’elle ait tenu face au cyclone. Depuis longtemps, il aurait dû la refaire. Même son frère le lui avait dit. Son frère qui aurait bien aimé, aussi, prendre la place de Mixon dans son coeur à elle.
Lorsqu’elle déboucha sur la mer, la première chose qu’elle vit, ce fut la frange de branches et de souches que les vagues avaient déposée, haut sur la plage. Cela formait comme une frontière sombre, avec d’un côté la mer, hostile, de l’autre la terre que les hommes lui disputaient en vain. Et puis elle vit, ou plutôt elle comprit que la pirogue n’était plus là.
La case avait tenu. Elle s’était affaissée sur le côté, mais elle n’était pas détruite. Une partie du toit s’était envolée. Tout était ouvert : porte et fenêtres. Le vent, en vainqueur, avait tout traversé, mais n’avait guère emporté. Le coeur lui battait dans la gorge, ses jambes tremblaient, après tout cet effort pour arriver jusqu’ici. Elle appela :
– Ohé, Mixon ! Jilo !
Mais déjà, elle savait.
La case était vide. Le vent, la pluie, avaient tout renversé, mouillé, cassé. Le plancher était recouvert de sable, les marmites étaient tombées, les matelas, jetés à même le sol, étaient trempés. Par-dessus, comme fait exprès, il y avait un vieux cahier ouvert, aux pages délavées par la pluie. Elle le prit. La plupart des mots étaient illisibles, et bien des pages étaient demeurées blanches. Sauf deux lignes, qu’elle eut du mal à déchiffrer… La date, sans doute, et en dessous, deux mots :
– Julia Malala… Julia, mon amour…
Dehors, le vent recommençait, son long cri de rage et de douleur.
Toutes ces années, il n’avait jamais cessé de l’appeler.
Par #LaurenceInk





















































































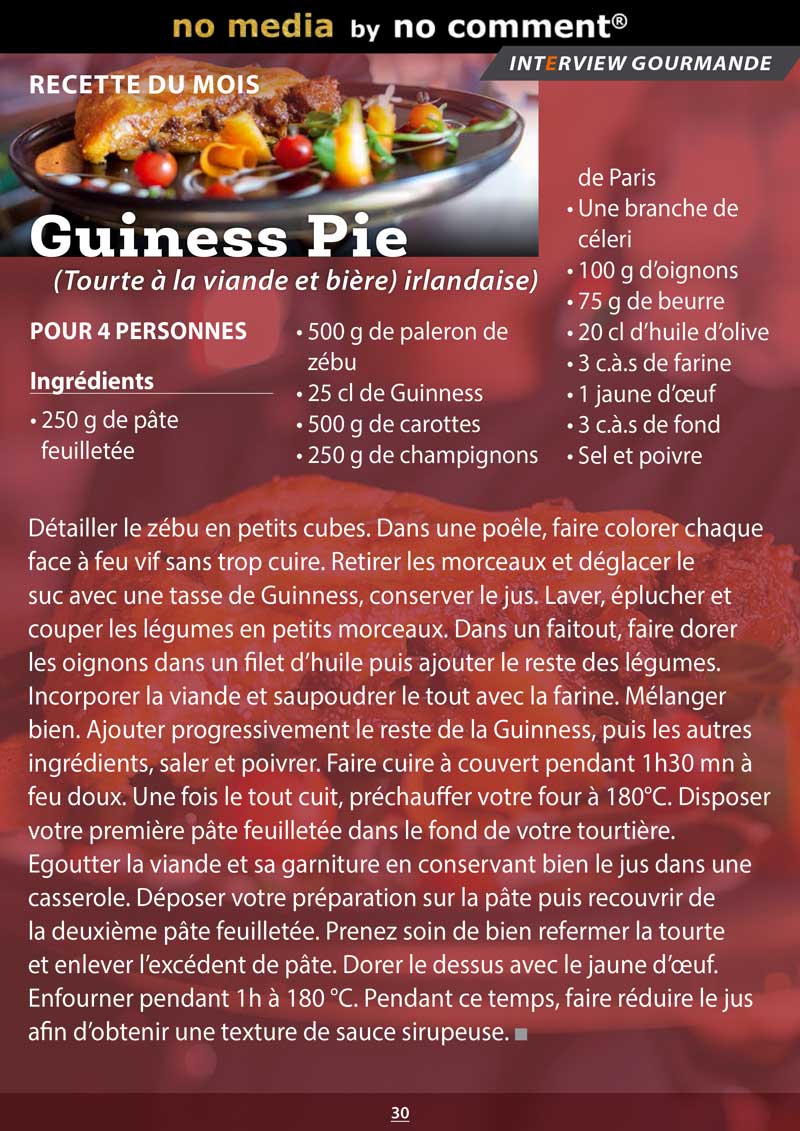

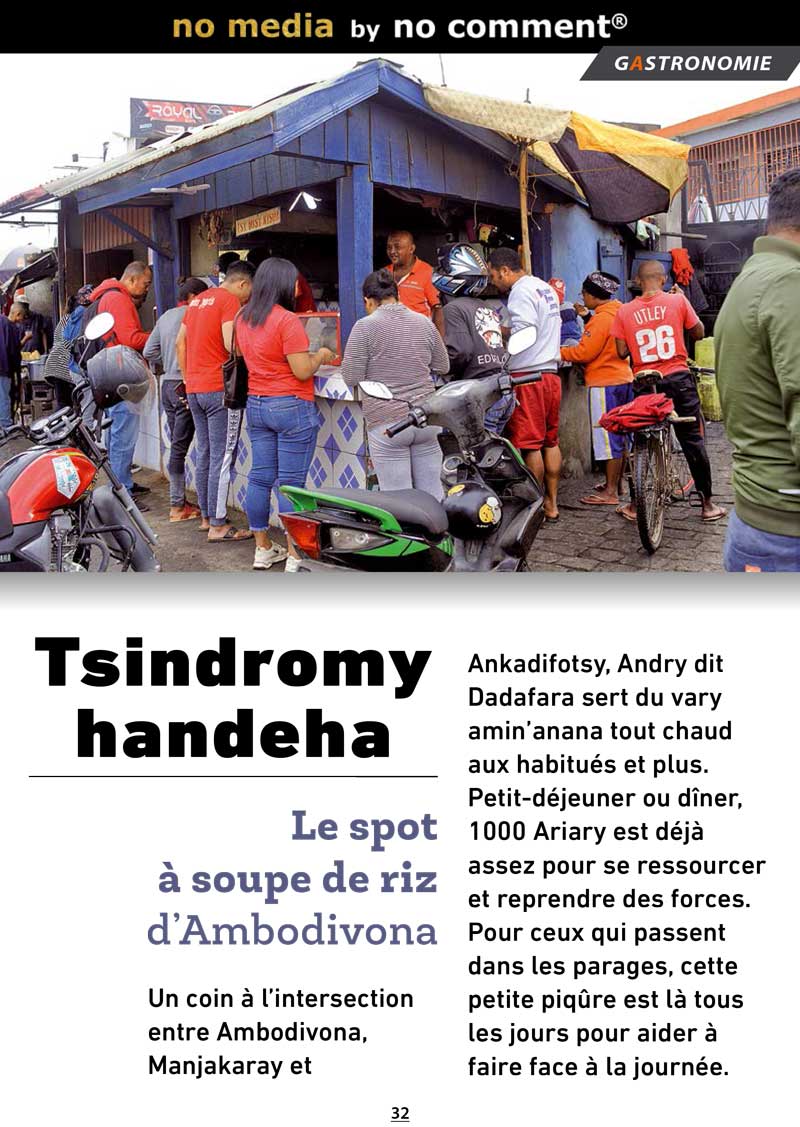






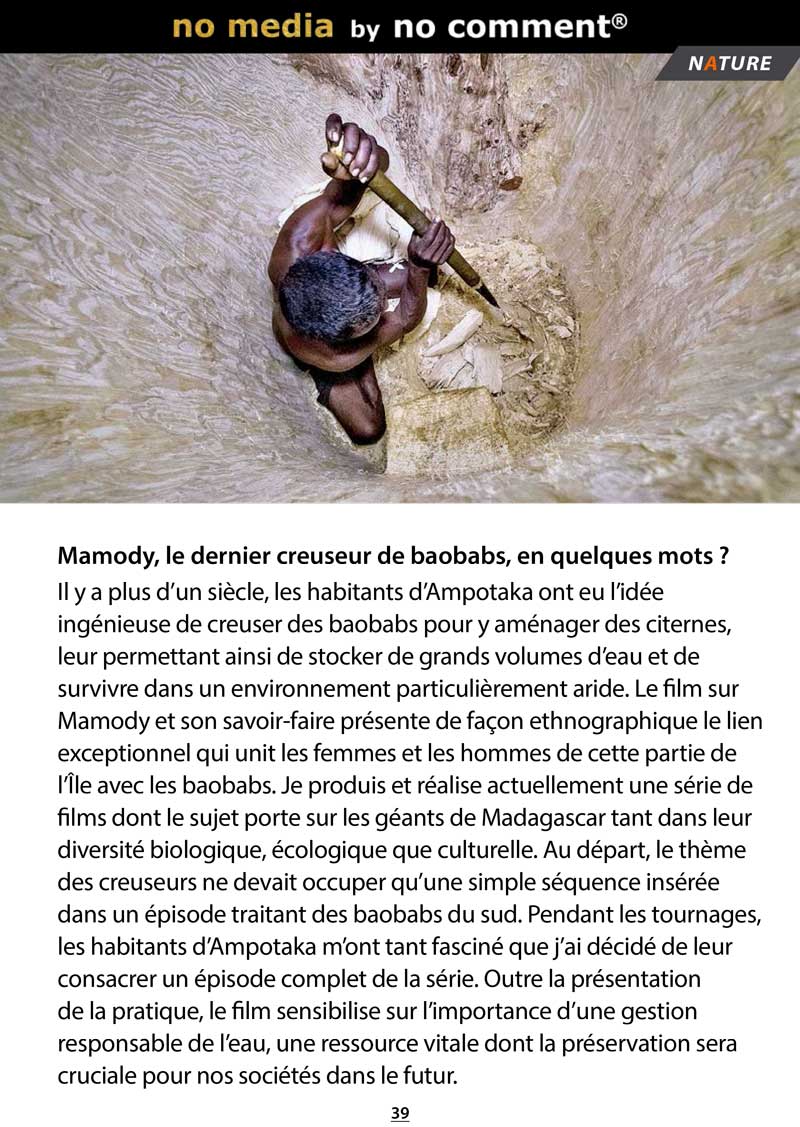




















COMMENTAIRES