Jean-Christian Bourcart
L’image seule ne donne rien à voir, quand elle ne ment pas…
Invité pour animer un stage destiné aux photographes malgaches, le lauréat du prix Nadar 2011 en a profité pour poursuivre dans les rues de Tana sa série sur les foules à travers le monde. Un certain regard. Qui va aux marges. Là où ça fait mal, mais jamais pour faire mal…

Comment un postmoderne qui travaille plutôt sur la déprime du vieux monde industriel en vient-il à s’intéresser à Madagascar, pays pauvre mais plein de sève ?
Je vis à New York depuis quinze ans et il est vrai que mon travail est plus orienté sur les Etats-Unis – le rêve américain ou ce qu’il en reste – que sur l’Afrique. Mais il se trouve que j’ai un frère qui habite ici depuis pas mal d’années et à qui je rends visite aussi souvent que je le peux.
Il y aussi que je me suis retrouvé en résidence artistique à Dakar en janvier 2011, et c’est dans ce prolongement, via les Instituts français, que j’ai eu l’opportunité d’animer ce stage de deux jours destinés aux photographes malgaches.
Que t’inspire les photographes d’ici ?
Deux jours, ce n’est pas assez pour faire le point. Je constate que mis à part Pierrot Men, peu d’artistes malgaches sont reconnus sur la place internationale, c’est le signe d’un décrochage certain par rapport au marché dominant. Trop de conservatisme. Alors que les couleurs explosent dans la rue ! J’ai envie de leur dire : osez un regard différent, ne vous censurez pas…
Tu es là aussi pour compléter ton travail sur les foules à travers le monde…
Après les embouteillages new-yorkais où je saisissais des tranches de vie au téléobjectif à travers les vitres des voitures (Traffic, 2004), avec I shot the crowd je travaille sur un espace plus ouvert, moins contraint, et je regarde comment l’hu ;main s’y déploie. C’est bizarre, dans une scène de foule il a toujours un personnage qui ressort, qui capte l’attention, et le tableau se compose autour de lui de façon très ample, un peu comme dans la peinture espagnole baroque.
Qu’est ce qu’on peut dire de la foule malgache ?
Ce n’est pas le désert de foule, chacun dans sa bulle, comme en Occident. C’est très organique, très coloré. Ce n’est pas non plus, comme en Chine, la foule unidirectionnelle qui semble tendre vers un destin unique. Ici ça part dans tous les sens, ça se croise, ça s’interpelle… Comme un joyeux désordre qui laisse toute sa chance à l’aléatoire, à l’humain, à la créativité. Je ne dis pas que j’ai tout capté de Madagascar, ce n’est que la troisième fois que j’y viens, forcément je me sens un peu à la surface des choses…
Est-ce que le fait d’avoir été photographe de presse influence ton travail actuel ?
Sans doute, mais j’ai été aussi photographe de mariages, et ça c’est la meilleure école ! Entre la photo de presse et la photo d’art, la frontière est mince – on est tous plus ou moins dans un même jeu de commandes – mais moi justement c’est cette frontière qui m’intéresse, j’adore jouer avec…
Quand je photographie Camden, ville du New Jersey réputée la plus dangereuse des Etats-Unis, avec ses dealers, ses junkies, ses prostituées, ça ressemble à du photojournalisme, sauf que c’est du photojournalisme où tous les codes sont détournés. Tu sais, ces gens qui vont dans les endroits les plus terribles de la planète, qui restent quelques jours à shooter sur le terrain et quand ils reviennent, on dit ce sont les nouveaux héros contemporains.
C’est de la pure mythologie ! Moi j’ai couvert Sarajevo au début des années 90, à l’époque où je travaillais pour l’agence Rapho, et c’est là que j’ai compris que le reportage de guerre était un spectacle de plus. C’est même pour ça que j’ai décidé en 1993 de carrément faire un film de fiction (Elvis). Pour être au plus près de ce que j’avais vu, et surtout ressenti, en Bosnie, car l’image seule ne donne rien à voir. Quand elle ne ment pas…
Procès des médias ?
Non, pas du tout ! Je serais très content si mes photos sur Camden paraissaient dans Paris Match. Seulement, en tant qu’artiste, je me dois à la plus grande honnêteté dans mon rapport au monde, je veux rendre compte d’une réalité qui est forcément plus complexe que ce qu’en disent les images.
C’est pourquoi dans mon travail j’utilise des formes de narration plus personnelles qui s’appuient aussi bien sur la photo, la vidéo, l’installation que l’écriture. C’est une vision plus kaléidoscopique du réel. Je dirais aussi que je manipule des symboles, des représentations, plus que de l’information. Comme pour Collateral, en 2005, où j’ai projeté des images de victimes iraquiennes sur des maisons, des supermarchés et des églises américaines…
Une chose fait que Capdem ne ressemble pas à un reportage de presse : l’absence de sensationnalisme…
Il est certain que je ne me suis pas cantonné à photographier les vendeurs de crack. Le traitement de l’image est même délibérément classique. Camden a beau être un immense dépotoir humain et industriel – le symbole du long déclin de la puissance américaine, car c’était encore une ville très prospère au milieu du XXe siècle – on y rencontre une humanité très ordinaire.
Des chômeurs, des alcoolos désoeuvrés, mais aussi quantité de gens disponibles et plutôt sympas. Les sociétés se délitent mais l’humain reste, c’est ça aussi la leçon de Camdem.
Diane Arbus est une de tes influences…
C’était une artiste très tourmentée. En regardant ses photos, on ne sait pas si c’est sa vision très noire qu’elle projetait sur l’american way of life ou si elle a contribué à révéler une réalité angoissante que personne n’avait vue avant elle : les deux sans doute.
Dans la même lignée, il y a Nan Goldin qui a photographié de façon très crue les milieux underground de New York (The Ballad Of Sexual Dependency). C’est une amie de longue date, elle m’a donné des textes pour Madones Infertiles (2002), mon travail sur les bordels de Francfort qui doit beaucoup au sien.

Cette photo prise à Isoraka s’intègre à ma série, actuellement en préparation, sur les foules. J’ai choisi un endroit très passant dans le quartier chinois, le soir à lumière douce, et comme toujours il y a un personnage qui ressort de lui-même. Ce n’est pas un désert de foule, chacun dans sa bulle, comme en Occident. Ca va dans tous les sens, ça se croise, ça s’interpelle. C’est beaucoup 58 plus organique, joyeux et colorée. L’homme n’est pas noyé, il nage dans la foule.
Jean-Christian Bourcart est un photographe français de 52 ans qui vit et travaille à New York depuis 1997.
Qu’il photographie les clubs échangistes (Forbidden City, 1999), les bordels de Francfort (Madones infertiles, 2002), les embouteillages urbains (Traffic, 2004), les foules à la dérive (I Shot the Crowd) ou encore Camden, ville réputée la plus dangereuse des Etats-Unis, il se veut le témoin « compassionnel » (au sens le plus bouddhiste) de ce qu’il appelle les « marges du monde » : ces trous noirs de la civilisation où l’étrangeté des choses et des êtres vous saute au visage mais donne encore à voir, contre toute attente, de l’humain.
Post-moderne ? Son oeuvre intègre aussi bien la photographie, la vidéo que l’écriture et a été de nombreuses fois récompensée : Prix Polaroid (1984) World Press Photo (1991), Prix du Jeu de paume (2007), Prix Nadar (2011, pour Camden).





















































































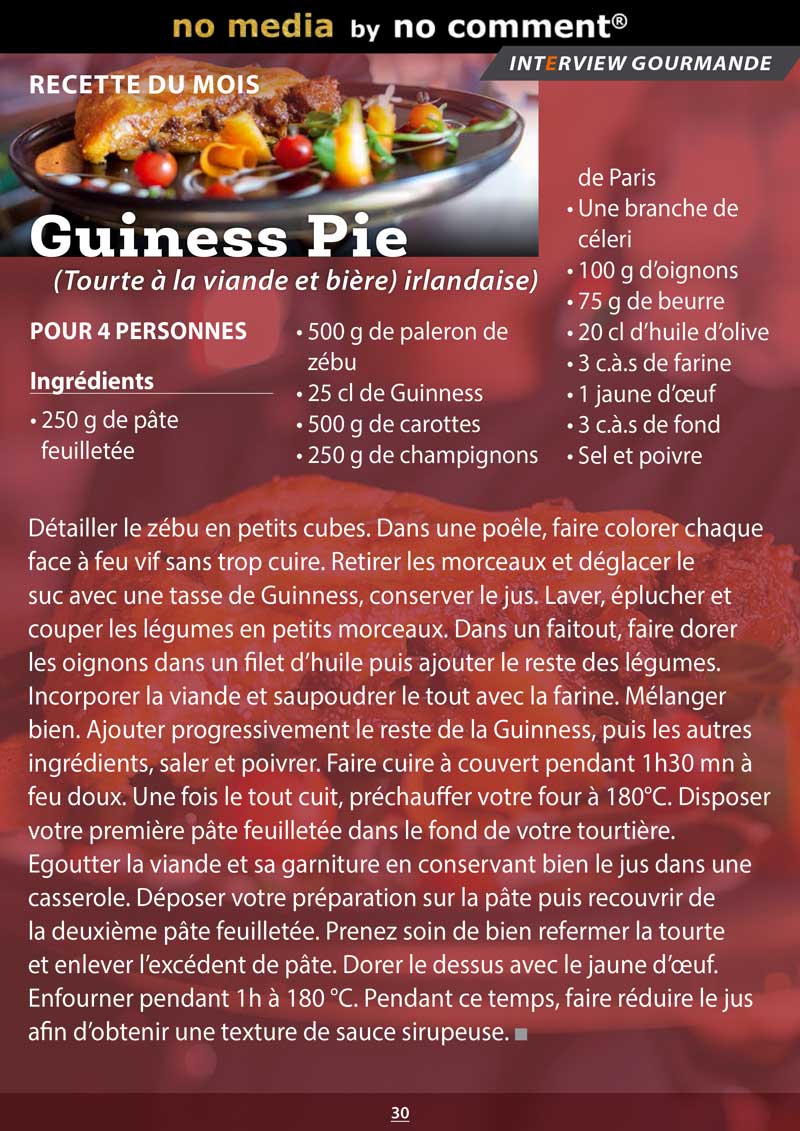

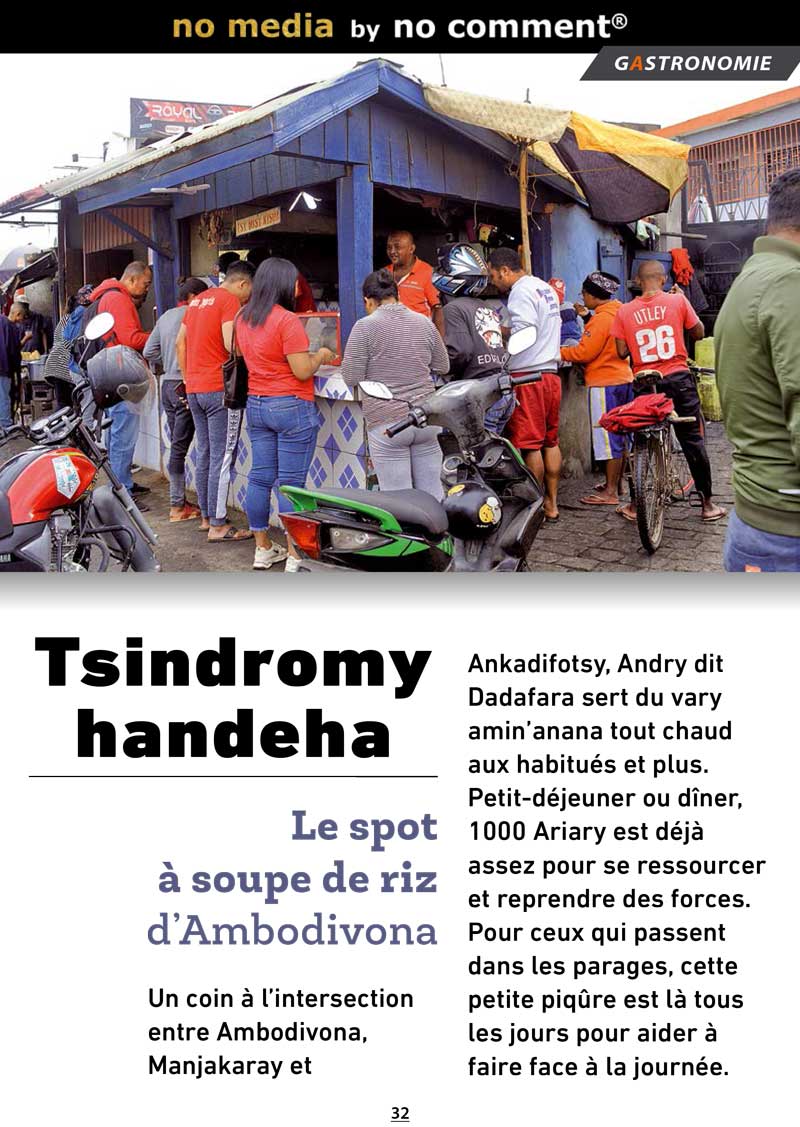






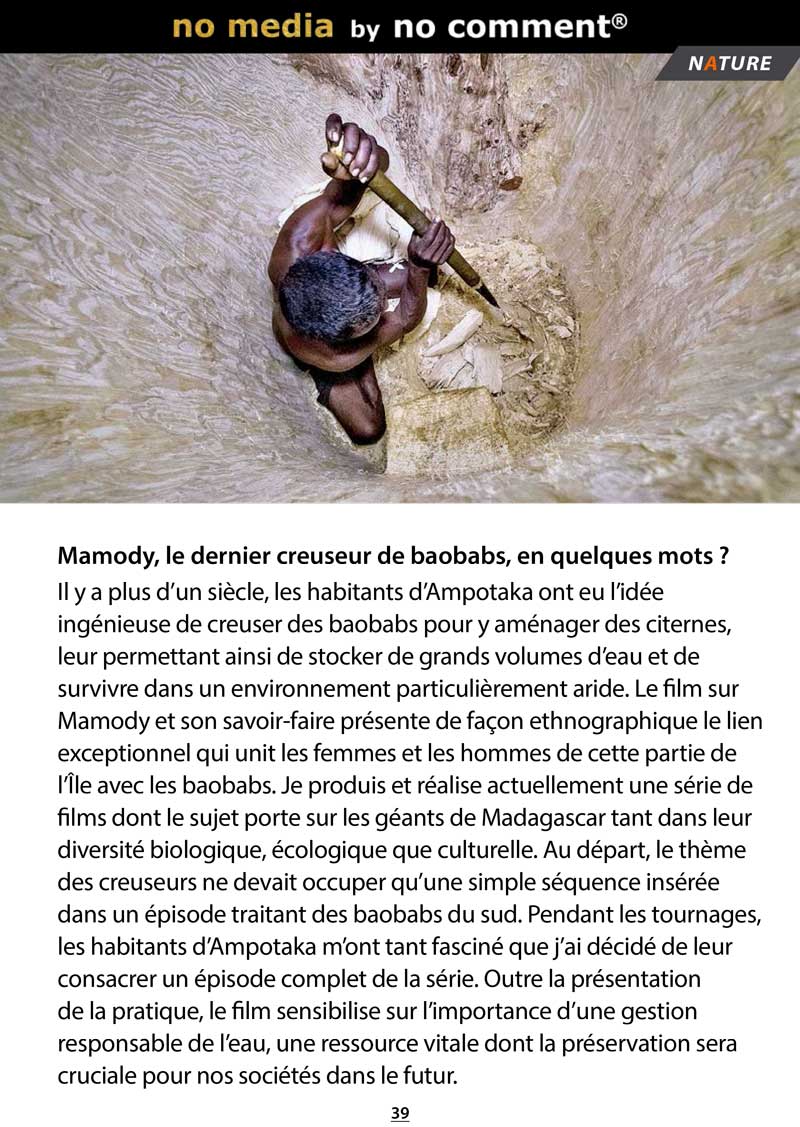




















COMMENTAIRES