Dany Be
Pionnier du photojournalisme à Madagascar, Daniel Rakotoseheno, dit Dany Be, encaisse avec encore pas mal de mordant ses 79 ans bien sonnés. À travers lui, c’est 50 ans de reportages qui défilent. Des sujets d’actu, devenus d’histoire, que seul un « humaniste en colère » pouvait avoir le front d’aborder.

Avec le recul, diriez-vous que toute indignation mérite sa photo ?
Moi je ne suis pas un professionnel de l’indignation. Je suis un humaniste qui prend des photos, ce n’est pas pareil ! Un humaniste en colère. Ce pays, tu as beau l’aimer avec passion, être prêt à tout lui sacrifier, il te blesse sans cesse, il te fait souffrir.
Je me souviens en janvier 1961 quand j’ai perdu une de mes filles à la maternité de Befelatanana. Elle avait cinq jours, brûlée dans la couveuse électrique à cause de la négligence d’une infirmière. J’ai bataillé pendant sept mois devant les tribunaux pour qu’on lui rende justice – j’ai reçu quoi ? Un franc symbolique. Pas un mot de regret, pas une excuse de l’administration.
C’est comme quand j’ai couvert le kere (famine) dans le Sud en 1992 : cette photo où l’on voit un vieillard squelettique agoniser au pied d’un enfant, au marché d’Ambovombe. Je l’ai faite ainsi, brute de décoffrage, pour qu’on comprenne bien ce que ça veut dire crever de faim, littéralement crever de faim, aujourd’hui à Madagascar.
Cette colère en vous, vous en connaissez l’origine ?
Oui et au jour près ! Je suis né à la politique, et d’une certaine façon à la vie, exactement le 2 avril 1947 quand mon père, le nationaliste Rakotoseheno, fondateur du journal La grande île, a été arrêté dans le sillage des événements du 29 mars. Ils l’ont amené à Antaninarenina, à ce qui s’appelait alors la Sûreté générale, pas loin de la Banque centrale actuelle. Il y est resté sept jours, et c’est moi qui lui apportais sa gamelle de riz.
J’avais 14 ans. Les gardiens, je les vois encore – des Sénégalais immenses – le faisaient sortir du rang devant moi, le saisissaient par les jambes et lui plongeaient la tête dans la barrique remplie d’excréments et d’urine qui servait de tinette aux prisonniers.
Après quoi ils me disaient d’aller chercher un seau d’eau pour lui en asperger le visage. « Voilà, il a mangé », ils rigolaient. Ça, c’est le Madagascar de mon enfance…
Paradoxalement, c’est dans l’armée française que vous découvrez la photo…
Je suis appelé en mai 1955 et affecté comme assistant photographe pendant 18 mois. On avait un lieutenant français qui faisait des photos pendant les marches de brousse. Ça m’a donné l’idée d’en faire autant, car j’avais remarqué qu’il ne voyait pas la même chose que moi pendant ces marches.
Moi je voyais les militaires entrer dans les maisons et emporter de la nourriture sans payer : un poulet, un canard, un oeuf, ce qu’ils trouvaient. C’était comme une armée d’occupation, et personne n’osait s’interposer. Le pire c’est que c’étaient des Malgaches comme moi, des Réunionnais, des Maliens, des Ivoiriens… une armée coloniale.
Plus tard, en septembre 1959, j’ai passé deux jours dans les geôles de l’armée française pour avoir pris des photos autour du camp militaire de Fiadanana. Ca s’est réglé à coups de ceinturon (j’en ai encore des cicatrices à l’épaule) et évidemment ils ont confisqué ma pellicule. Pour dire que c’était très tendu sur la fin…
L’Indépendance, c’est en jeune photoreporter que vous la vivez…
En 1960, j’entre au Courrier de Madagascar qui s’appelait encore Madagascar Dimanche – c’est après qu’il est devenu un quotidien, d’ailleurs le plus vendu de l’île. On est dans ce grand mouvement de la décolonisation des années soixante et l’époque respire vraiment l’optimisme.
Je me souviens le 18 mai 1963 quand j’ai couvert la création de l’OUA (Organisation de l’unité africaine) à Addis-Abeba avec la délégation malgache conduite par le président Tsiranana.
On sentait que c’était un grand moment d’histoire, une histoire que nous enfin on écrivait. J’étais là également aux J.O. de Mexico en 1968 quand Jean Louis Ravelomanantsoa les caméras du monde ! On se disait : pas de doute, on existe maintenant, une page est tournée. Enfin presque… En 1971, toujours pour le Courrier, je me suis retrouvé en Afrique du Sud avec l’Union sportive de Saint-Michel. C’était l’apartheid, j’ai passé une nuit au trou pour être entré dans un restaurant réservé aux « Blancs »…
Le « Courrier de Madagascar » ne survit pas aux événements de mai 1972…
Il était financé par le Pouvoir, donc très mal vu des étudiants. Le 13 mai, ils ont brûlé les locaux et c’était fini. Moi j’étais de leur côté, j’ai même couvert la totalité du soulèvement avec eux.
Il faut dire que quelque mois plus tôt, en mars, on m’avait viré du canard ! On ne me pardonnait pas d’avoir couvert les grandes révoltes paysannes de 1971, les fameuses « jacqueries du Sud » comme les avait appelées Le Monde.
J’étais le seul photographe de presse à avoir accompagné le nationaliste Monja Jaona durant ces 20 jours d’insurrection. Et j’étais là, le 1er avril, quand ça a vraiment pété, avec cette photo où l’on voit Monja Jaona refuser de se mettre à genou pour abdiquer.
Opposant par principe ?
Non, juste un journaliste qui aurait aimé qu’on lui laisse faire son métier dans les conditions normales d’une démocratie. En 1974, quand j’ai créé Sary avec des collègues, on ambitionnait d’être la première agence de presse privée, indépendante de l’État. L’aventure n’a duré que quelques mois.
Un jour les gendarmes ont débarqué et ils ont tout mis sous scellés : pas assez coopératifs, on n’avait pas l’autorisation de travailler. Je me souviens encore, le 14 juillet 1983, quand les flics ont débarqué chez moi pour m’amener à la DGID d’Ambohibao, la police politique de l’époque. Motif : atteinte à la sûreté de l’État ! J’avais assisté, comme photojournaliste, à une réunion où certainement ça complotait un peu… Total, 31 jours de cellule avec pratiquement rien à manger.
Surtout on m’a volé 2 000 pellicules pleines, toutes mes archives des années 60 et 70. Jamais retrouvées. Bien plus tard, de 1997 à 2007, quand je me suis retrouvé responsable du Centre de ressources des médias du Cite et que j’organisais pour les jeunes ces Journées mondiales de la liberté de presse, j’en connaissais le prix…
Quelle est la place de l’artiste dans cette oeuvre qui est d’abord de témoignage ?
Elle est énorme. J’ai toujours apporté beaucoup d’attention au cadrage et à la lumière. Surtout que je viens de l’argentique, un monde où il fallait tout calculer dans sa tête, les ouvertures, les diaphragmes, avant d’appuyer sur le bouton.À l’époque, la photo était le fruit d’un calcul, d’une intention…
Comme on disait, c’est l’oeil qui fait la photo, pas l’appareil. J’ai commencé avec un Nikon, ensuite j’ai eu mon Nikomat ramené d’Argentine en 1972 : objectif 24 mm et téléobjectif 85/35, un rêve ! Rien que de le toucher, j’en ai encore des frissons.
Pas comme ces appareils actuels qui règlent tout et font quasiment la photo à ta place. Toutes ces photographies de salon retouchées à l’ordinateur, où il ne se passe plus rien. Absolument sans âme et sans projet. Je me dis que j’ai peut-être vécu un Âge d’or…
Propos recueillis par #AlainEid






































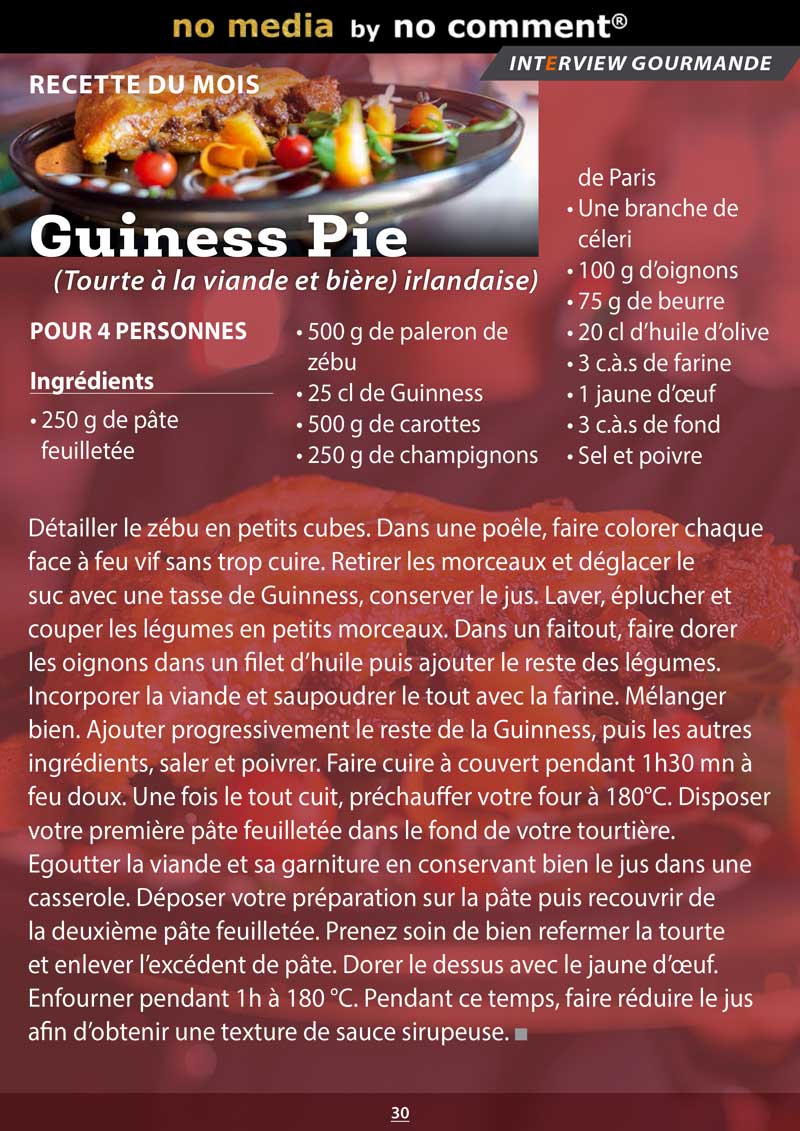

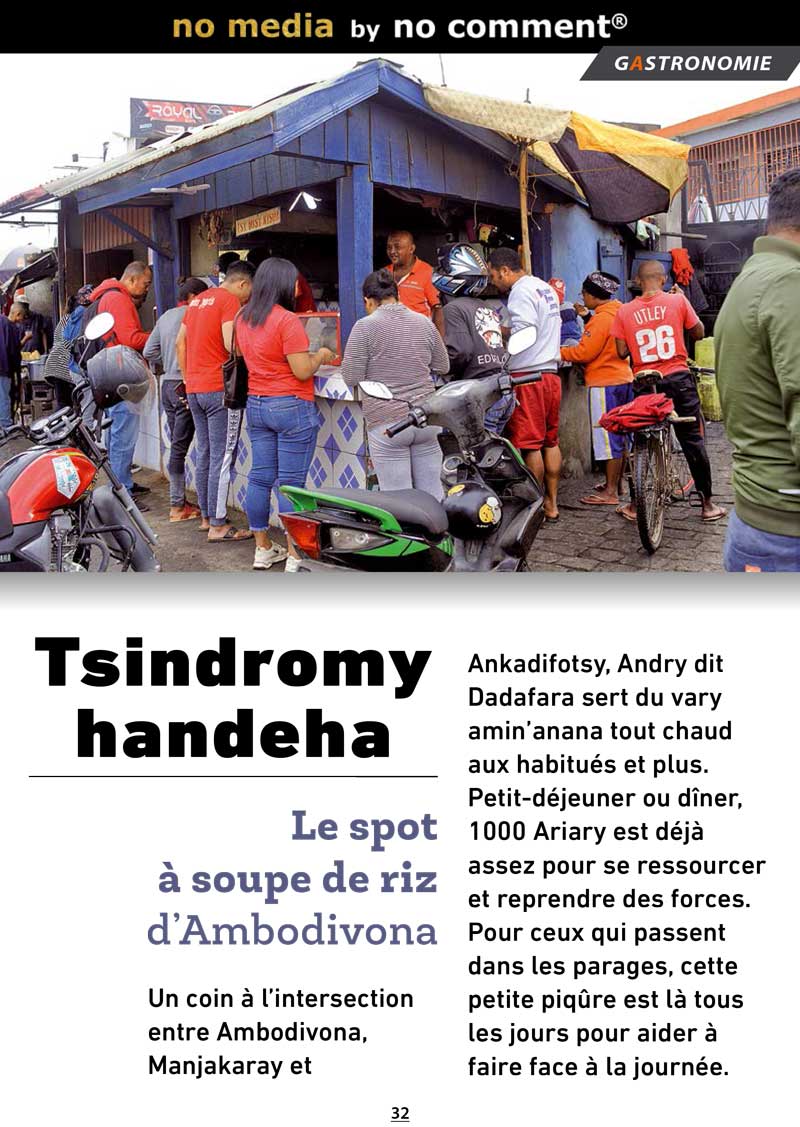






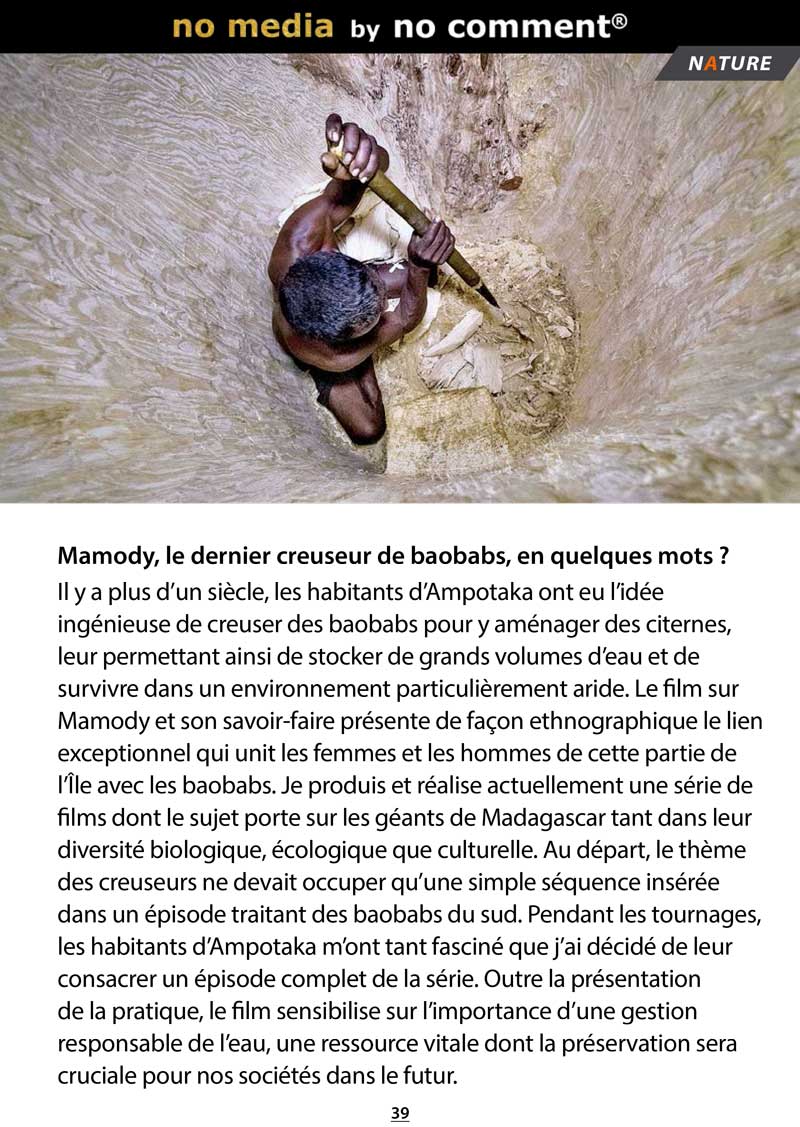





















COMMENTAIRES